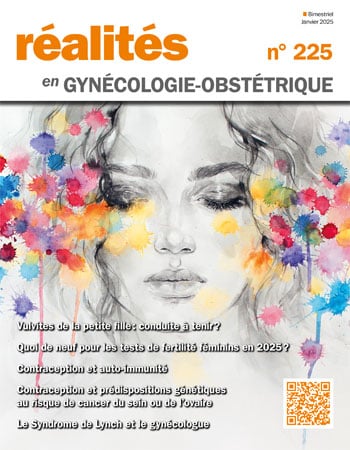La contraception chez l’adolescente
La prescription d’une contraception à l’adolescence doit être adaptée aux enjeux spécifiques à cet âge : une fertilité élevée, une exposition fréquente aux IST, un accès parfois limité à la consultation de gynécologie et aux traitements.
Toutes les méthodes de contraception sont envisageables. La stratégie de prescription doit tenir compte des antécédents de la patiente, de son mode de vie mais aussi des conséquences de l’initiation précoce d’un traitement hormonal sur sa santé à plus long terme.
L’objectif est de guider au mieux l’adolescente tout en respectant son autonomie et son intimité : la création d’une relation de confiance pourra s’avérer déterminante dans la suite de son suivi gynécologique.

Le choix de sexe dans les variations du développement génital : quelles avancées ?
L’aspect des organes génitaux du nouveau-né est le critère de déclaration du sexe à la naissance. Le choix de sexe est une situation rare en pratique clinique chez les enfants nés avec des organes génitaux atypiques, la question ne se posant que pour les enfants chez lesquels l’apparence des organes génitaux externes est tellement inhabituelle que la déclaration de sexe à l’état civil n’est pas possible à la naissance et chez les enfants dont l’apparence est non congruente avec le sexe génétique prénatal.
La prise en charge de ces enfants se coordonne dans des centres maladies rares et fait intervenir des équipes pluridisciplinaires (pédiatres, psychologues et psychiatres, radiologues, généticiens, chirurgiens…). Les avancées récentes juridiques, diagnostiques et thérapeutiques sont décrites dans cet article.

Le consentement en gynécologie
Le préalable à l’obtention d’un consentement éclairé en gynécologie est l’information fournie à la femme. C’est un des temps forts de la consultation, permettant d’expliquer le traitement envisagé et de répondre aux interrogations. La loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner) encadre cette pratique.
Chaque femme a un abord différent de l’information et de la délivrance de son consentement. La femme conformiste a une adhésion complète au gynécologue et ne négocie pas. Pour elle, le consentement apparaît tacite. La femme contractualiste s’est renseignée avant la consultation et pose des questions. Elle base son consentement sur un contrat avec le gynécologue. La féministe remet parfois en cause le savoir médical et négocie avec le gynécologue. Elle vit la consultation comme un rapport de pouvoir et ne donne son consentement que par nécessité.
La communication, endogène à chacun mais trop peu enseignée dans les études médicales, est la clé du dialogue médecin-patiente.

Actualités dans les infections sexuellement transmissibles par le GrIDIST
Les infections sexuellement transmissibles (IST) concernent plusieurs millions de personnes chaque année. Aujourd’hui, elles sont toujours au centre des préoccupations. L’émergence de résistances, en particulier pour le gonocoque mais aussi pour Mycoplasma genitalium, rendent plus complexes les prises en charge par les antibiotiques.
Le développement de la prophylaxie préexposition (PreP) au VIH permet de réduire l’incidence de l’infection par ce virus mais laisse entrevoir une augmentation de l’incidence des autres IST du fait de la moindre utilisation du préservatif.
La gravité de la symptomatologie et du pronostic dépendra du type d’IST acquise. Une plus ample couverture vaccinale contre les papillomavirus humains permettra une large réduction de ses infections et cancers induits.

Endométriose et contraception
L’endométriose est une maladie chronique invalidante touchant de nombreuses femmes et dont les manifestations principales sont des douleurs pelviennes chroniques et/ou une infertilité. La prescription d’une contraception hormonale a un rôle clé dans la prise en charge de la douleur, dans la réduction de la progression des lésions endométriales ainsi que dans la prévention des récidives postopératoires.
Il est recommandé de prendre en charge l’endométriose lorsqu’elle a un retentissement fonctionnel (douleur, infertilité) ou lorsqu’elle entraîne une altération du fonctionnement d’un organe. Une prise en charge globale de la douleur sur le plan médicamenteux, parfois chirurgical, et associée à des thérapeutiques alternatives est nécessaire afin d’améliorer la qualité de vie des femmes souffrant de douleurs pelviennes chroniques.

Forces et faiblesses du test HPV dans le dépistage des lésions de dysplasie cervicale
Le test de détection du papillomavirus humain à haut risque (HPV-HR) occupe une place centrale dans le dépistage organisé du cancer du col utérin en France. Après un rappel sur les recommandations actualisées en 2019 par la HAS, cet article a pour objectif de démontrer les points forts du test HPV-HR, qui résident principalement dans son excellente sensibilité, les apports de son utilisation par rapport à la cytologie conventionnelle dans le dépistage et le cadre de la surveillance thérapeutique, mais aussi de montrer ses limites et les conséquences sur le risque d’un recours accru à la colposcopie du fait de sa mauvaise valeur prédictive positive.

Psoriasis et procréation
Plus d’un quart (26,2 %) des patients souffrant de psoriasis en France sont des femmes en âge de procréer [1]. Qu’elles aient ou non un psoriasis génital, leur sexualité est altérée et il appartient au dermatologue d’aborder le sujet afin que les patientes jeunes puissent s’autoriser à envisager une vie normale et un projet de grossesse sans inquiétude.
Les recommandations nationales mais aussi les données de pharmacovigilance permettent aujourd’hui de choisir un traitement à la fois efficace et non fœto-toxique afin que la patiente puisse être traitée de façon optimale jusqu’à la déclaration de grossesse, voire au cours de sa grossesse si cela est jugé nécessaire.

Prolapsus et rééducation périnéale
Le prolapsus touche de nombreuses femmes et reste un sujet tabou. La prise en charge sera rééducative, analytique (rééducation manuelle, électrothérapie et biofeedback) mais surtout globale (réintégrer le périnée dans son enceinte abdominale en corrigeant la posture et en réintégrant la co-activation musculaire), sans oublier l’éducation thérapeutique. Le pessaire peut également être proposé avec un accompagnement par un rééducateur ou un médecin. Ce n’est seulement qu’en cas d’échec de ces traitements et de symptômes persistants qu’une chirurgie pourra alors être proposée.

Hyperandrogénie en postménopause
Les manifestations cliniques de l’hyperandrogénie en postménopause sont variables et la sévérité du tableau clinique n’est pas systématiquement corrélée à la sévérité de l’hyperandrogénie biologique.
Le dosage de la testostérone totale est l’examen complémentaire de première intention pour confirmer l’hyperandrogénie. Son interprétation est spécifique en postménopause avec des valeurs
normales deux fois moindres que chez la femme non ménopausée. Le bilan étiologique recherchera une tumeur androgénosécrétante. Les autres diagnostics à rechercher sont les causes iatrogènes, le SOPK persistant après la ménopause, l’hyperthécose ovarienne, l’hyperplasie congénitale des surrénales, le syndrome de Cushing et l’acromégalie.
La stratégie thérapeutique repose le plus souvent sur une chirurgie.

Dépistage du cancer du sein en cas de risque familial
En 2014, la Haute Autorité de santé (HAS) a mis en œuvre des stratégies de dépistage spécifiques chez les femmes considérées comme à “haut risque”.
La consultation d’oncogénétique contribue à évaluer un risque individuel à partir d’une histoire familiale pour en tirer les recommandations sur un parcours optimisé de suivi. En cas d’altération génétique identifiée, une surveillance mammaire clinique et radiologique rapprochée sera proposée, avec possibilité d’avoir recours à une chirurgie de réduction de risque. En cas d’antécédent familial de cancer du sein avec un score d’Eisinger ≥ 3 et en l’absence d’identification d’une mutation génétique dans la famille, l’utilisation d’un score de calcul de risque permettra d’adapter le niveau de risque, “élevé” ou “très élevé”.