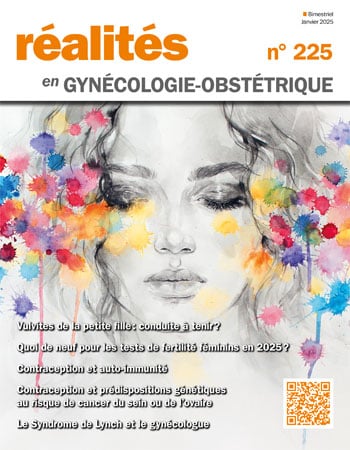Mini-atlas de pathologie vulvaire
Ce mini-atlas très didactique a pour but d’illustrer les principales…

Thrombopénie immunologique et grossesse
La thrombopénie immunologique est la plus fréquente des cytopénies auto-immunes. Elle représente la première cause de thrombopénie au cours du 1er trimestre de grossesse. Le diagnostic repose sur l’exclusion de l’ensemble des causes de thrombopénie (hématologiques, immunologiques, infectieuses, gravidiques).
La nécessité de débuter un traitement spécifique au cours de la grossesse dépend de deux paramètres majeurs : la présence de manifestations hémorragiques et le terme obstétrical. La prise en charge thérapeutique repose essentiellement sur la cortisone et les immunoglobulines intraveineuses (utilisées en cas de sévérité, de corticorésistance ou de contre-indication à la corticothérapie).
La période de l’accouchement est critique du fait d’un risque hémorragique propre et d’un objectif de plaquettes ≥ 75 g/L afin de permettre la réalisation d’une anesthésie locorégionale. Une thrombopénie néonatale est possible, ce qui nécessite des précautions à l’accouchement vis-à-vis du risque hémorragique fœtal et une surveillance du taux de plaquettes du nouveau-né à la naissance et dans la première semaine de vie. La complexité de la prise en charge requiert une concertation pluridisciplinaire et un suivi dans un centre spécialisé.

Dépistage prénatal non invasif : mode d’emploi
Depuis quelques années, il est possible de proposer aux femmes enceintes un test de dépistage de la trisomie 21 basé sur la présence d’ADN fœtal circulant dans le sang maternel. Ce test, souvent nommé DPNI pour dépistage prénatal non invasif, a une bien meilleure sensibilité et spécificité que le dépistage combiné proposé depuis 2009.
Des sociétés savantes puis, en mai 2017, la Haute Autorité de Santé ont publié des recommandations concernant l’utilisation des tests sur ADN fœtal circulant dans le sang maternel dans le cadre du dépistage de la trisomie 21.
L’accompagnement médical des couples dans cette démarche reste important au vu des enjeux éthiques soulevés. Nous aborderons dans cet article les nouvelles recommandations, les indications et contre-indications du DPNI.

Microbiotes et périnatalité
L’accouchement et la période post-natale précoce sont des événements déterminants dans l’installation du microbiote intestinal de l’enfant et donc de ses défenses immunitaires. Des altérations précoces de ce microbiote sont incriminées dans l’obésité de l’enfant, la survenue d’un diabète de type 1, de maladies inflammatoires, de désordres neuropsychologiques et de manifestations ou maladies allergiques.
L’accouchement par césarienne altère la qualité de ce microbiote par comparaison avec celui des enfants nés par voie vaginale (diminution des Bifidobacterium stimulateurs du système immunitaire). Ces anomalies sont transitoires et disparaissent à partir du 3e mois de vie, d’autant plus rapidement que l’enfant est allaité au sein.
Enfin, l’environnement familial (existence d’une fratrie, contact avec des animaux à fourrure…) peut s’avérer un élément stimulant pour l’établissement d’un système immunitaire équilibré alors que l’exposition aux antibiotiques (y compris en prénatal) a une action délétère sur ce système.

Les troubles psychiatriques du post-partum
Les troubles psychiatriques du post-partum sont des décompensations psychiques liées au processus du devenir parent et spécifiques de la première année postnatale. Très fréquents, ils touchent 20 % des jeunes parents. Nous décrirons les troubles de l’humeur, du baby-blues à la dépression plus ou moins sévère, jusqu’à l’état mixte ou la manie délirante, mais aussi les troubles anxieux et post-traumatiques. Ils ont en commun leurs facteurs de risque : vulnérabilité psychiatrique antérieure, précarité psychosociale et facteurs obstétricaux (grossesse ou accouchement compliqués).
Leur principale complication évolutive concerne l’enfant car ces troubles parentaux peuvent affecter les interactions parents-bébé et influer de manière néfaste sur tous les domaines de son développement. Savoir les reconnaître, les rechercher et les prendre en charge constitue donc un enjeu majeur en périnatalité.

Maladie thromboembolique veineuse de la grossesse : nouvelles données, nouvelles recommandations, nouvelles attitudes !
Au cours de la grossesse et du post-partum, le risque de maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est augmenté en raison de la dilatation veineuse, de la gêne au retour veineux par l’utérus gravide et d’un état “d’hypercoagulabilité”. Ce risque est présent dès le début de la grossesse et persiste jusqu’à 12 semaines après l’accouchement.
La MTEV représente en France la 2e cause directe de mortalité maternelle. L’appréciation du risque est fondamentale pour adopter une attitude de prévention efficace. Les situations à risque doivent être reconnues et réévaluées tout au long de la grossesse et particulièrement dans le post-partum.
Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) doivent être prescrites en cas de risque élevé. Le port de bas ou chaussettes de compression classe 2 peut être utile en prophylaxie dans les situations à risque et associé à des HBPM en cas de risque élevé.

L’accouchement des femmes enceintes de jumeaux en France
Les grossesses gémellaires représentent 3,6 % des naissances en France. Elles sont grevées d’une augmentation importante des risques maternels mais surtout néonataux comparées aux grossesses monofœtales.
L’étude JUMODA a montré un faible taux de morbidité néonatale en population générale pour les patientes accouchant à partir de 32 SA avec un premier jumeau en présentation céphalique. Surtout, elle a mis en évidence que :
– la tentative de voie basse pour ces patientes n’était pas associée à une augmentation de la morbidité néonatale en comparaison avec la césarienne programmée ;
– la césarienne programmée était associée à une augmentation de la morbidité néonatale en comparaison à la tentative de voie basse entre 32 SA et 37 SA.
Ainsi, il n’existe plus d’obstacle à recommander la tentative de voie basse aux patientes enceintes de jumeaux accouchant à partir de 32 SA avec un premier fœtus en présentation céphalique.

Vaccination anti-HPV : que penser ?
Pour éradiquer le cancer du col utérin, il est impératif de suivre les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur la vaccination et le dépistage.
Les expériences menées dans différents pays ont montré que les campagnes de vaccination anti-HPV (Human Papilloma Virus ou papillomavirus humain) réalisées en milieu scolaire sont les seules à être vraiment efficaces, avec l’adoption d’un schéma vaccinal à deux doses pour les jeunes filles de moins de 15 ans. La couverture vaccinale atteint 80 % dans la plupart des pays. La France n’a malheureusement pas répondu à cet appel, avec 2 797 nouveaux cas en 2015 et un taux d’incidence de 5,9/100 000.
Les programmes de vaccination sont souvent la cible des vaccino-sceptiques et seule une réponse officielle forte, bien documentée et validée sur le plan scientifique pourra vaincre ces réticences. Nous avons à présent les moyens de protéger efficacement et en toute sécurité les jeunes filles contre le HPV. Il est important de communiquer ces bonnes nouvelles aux professionnels de la santé, aux citoyens de même qu’aux responsables de la Santé Publique.

Microbiotes et grossesse
La grossesse est une période de profondes modifications des microbiotes maternels (vaginal, intestinal, oral). Ces modifications ont pour but de créer les conditions métaboliques favorables au développement du fœtus. Mais les dysbioses agissent également en altérant le déroulement de la grossesse (prématurité, diabète gestationnel, par exemple).
En ce qui concerne la vaginose bactérienne, les traitements antibiotiques classiques n’ont pas montré d’action préventive sur la prématurité. La multiplication de ce type de traitement est donc inefficace, voire dangereuse.
La voie des probiotiques est prometteuse comme le démontrent des études sur la dysbiose intestinale. Un certain nombre d’interrogations demeurent sur ces traitements : quelle est la meilleure voie d’administration ? Quelles souches utiliser ? Quelle durée de traitement ? Leur impact sur le microbiote placentaire récemment découvert reste également à préciser.

Infection du site opératoire en chirurgie gynécologique : physiopathologie et prévention.
Les infections du site opératoire (ISO) représentent une importante source de morbidité et de mortalité en chirurgie. Environ 2-5 % des chirurgies et 2 % des hystérectomies se compliquent d’ISO et ces taux sont probablement sous-estimés. En effet, la traçabilité de ces infections est aléatoire car elles se manifestent souvent après l’hospitalisation. Les ISO sont responsables d’un impact socio-économique conséquent. Aux États-Unis, il est estimé qu’une ISO compliquant une hystérectomie augmente son coût d’environ 5 000 $.