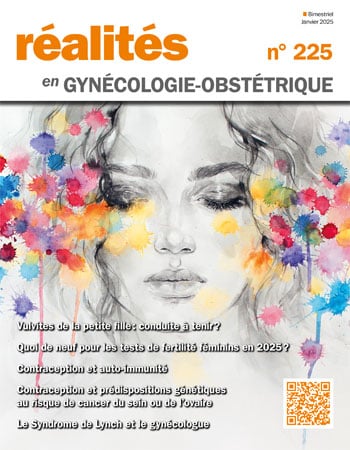Dépression du post-partum : dépister avant tout !
La grossesse et le post-partum sont des périodes à risque de survenue d’un trouble psychique. On estime que 10 à 15 % des parturientes développent une dépression du post-partum (DPP). Les facteurs de risque les plus souvent retrouvés sont la primiparité, les antécédents personnels et familiaux de dépression et l’absence de soutien social perçu ou réel.
Les symptômes devant faire soupçonner le développement d’une DPP sont une humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur, des plaintes somatiques dont l’asthénie, une labilité émotionnelle et une irritabilité, ainsi que tout trouble psycho-fonctionnel chez l’enfant. On peut évaluer ces symptômes avec l’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).
On recommande un dépistage systématique de la DPP, puis une prise en charge transversale et intégrative. Dans certains cas, on peut également recourir à une hospitalisation conjointe en unité mère-enfant.

Syndrome des ovaires polykystiques et infertilité
Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est fréquemment rencontré en gynécologie. Sa physiopathologie est complexe et de nombreuses théories ont été proposées dans le temps.
Le SOPK peut être responsable d’infertilité et requiert une prise en charge pluridisciplinaire. Différents traitements sont envisageables, ils doivent tous être monitorés. Les complications fréquemment rencontrées en médecine de la reproduction sont le syndrome d’hyperstimulation et les grossesses multiples.

Précarité sociale, santé maternelle, santé périnatale
La précarité sociale est un facteur de risque périnatal et maternel aujourd’hui connu. L’analyse des mécanismes qui expliqueraient comment les différentes dimensions de la condition sociale des femmes interagissent avec les indicateurs de santé maternelle et/ou périnatale a permis d’identifier un certain nombre d’éléments susceptibles de jouer un rôle de facteurs intermédiaires. Parmi ceux-ci, le tabagisme, l’obésité maternelle, l’usage de drogues, l’exposition à des stress psychologiques et physiques, les infections génitales, la pénibilité du travail et très certainement l’accès aux soins et, de manière plus large, la qualité du suivi prénatal.
La précarité maternelle étant un authentique facteur de risque médical, il est important de la dépister et de la prendre en compte dans l’organisation du suivi prénatal.

Évolution de la sexualité au cours des 50 dernières années
Nos pratiques sexuelles se sont largement diversifiées au cours des dernières décennies. Le contexte global de notre sexualité a évolué lui aussi, profondément bouleversé par les changements de nos représentations de la masculinité, de la féminité et de notre société. À l’ère d’internet, des objets connectés et de la fluctuation du genre, qu’est devenue notre sexualité ?

Allaitement : les nouvelles recommandations
L’accompagnement d’une patiente lors de l’allaitement maternel est essentiel. Il commence durant la grossesse et peut se poursuivre à tout moment car les interrogations sont nombreuses. D’une manière générale, plus on favorise les mises au sein sans élément extérieur, plus l’allaitement a des chances de réussir. Il faut une quinzaine de jours pour une bonne mise en route et il est essentiel de respecter le rythme du bébé.
Quant au sevrage, il est donc essentiel qu’il se fasse quand la patiente le choisit. L’idéal est qu’il soit progressif.

Déficits en 21-hydroxylase et fertilité féminine
Le déficit en 21-hydroxylase est la maladie génétique surrénalienne la plus fréquente, responsable du tableau clinique d’hyperplasie congénitale des surrénales. Selon la sévérité des mutations du gène CYP21A2, on observe des formes sévères dites “classiques” et des formes modérées dites “non classiques”.
Le déficit enzymatique induit une perturbation de la stéroïdogenèse surrénalienne qui va provoquer une hyperandrogénie et une élévation des taux plasmatiques de progestérone et de 17- hydroxyprogestérone. Tous ces anomalies endocriniennes concourent à un état d’infertilité féminine d’autant plus sévère que le déficit enzymatique est profond.
L’aspect génétique préconceptionnel est également capital pour anticiper les conséquences de la transmission d’une forme classique de déficit en 21-hydroxylase à la descendance.
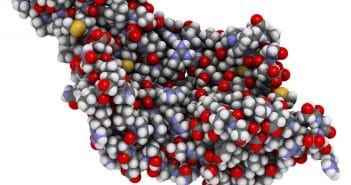
Marqueurs de la prééclampsie : mise au point
La prééclampsie est une affection protéiforme dont le déterminisme est multifactoriel et mal connu. Depuis plus d’une décennie, des avancées significatives ont néanmoins été faites dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques qui la sous-tendent. Le dysfonctionnement placentaire qui joue un rôle central dans la maladie est associé à des anomalies des facteurs pro- et anti-angiogéniques en particulier PlGF et sFlt-1. Ces facteurs responsables de l’homéostasie de l’endothélium vasculaire ont des concentrations qui évoluent anormalement plusieurs semaines avant la survenue des anomalies clinico-biologiques habituelles. Le dosage de ces biomarqueurs peut ainsi apporter une aide concrète pour le clinicien en cas de suspicion diagnostique et peut-être, à l’avenir, dans le dépistage précoce de l’affection.

La prise en charge multidisciplinaire des douleurs pelviennes chroniques
La douleur pelvienne chronique (DPC) est définie par la présence d’une douleur située dans le pelvis, sous l’ombilic, depuis plus de 6 mois, suffisamment sévère pour entraîner une incapacité ou nécessiter un traitement médical et/ou chirurgical. Elle concerne entre 2 et 24 % des femmes selon les études et son incidence est comparable à celle de l’asthme ou des lombalgies.
Différents organes peuvent être touchés par de multiples pathologies, parfois en association, ce qui rend la prise en charge complexe.
Les différentes étiologies possibles, la nature chronique de la DPC et l’influence de facteurs biologiques, sociaux et comportementaux encouragent à une prise en charge multidisciplinaire incluant médecins, kinésithérapeutes et psychologiques.

Traitement des troubles vasomoteurs de la ménopause sans estrogènes
La physiopathologie des bouffées de chaleur est encore incomplètement connue. L’évaluation de la prise en charge est impactée par le manque de critères objectifs d’évaluation et par l’ampleur de l’effet placebo. Le traitement le plus efficace repose sur les estrogènes.
De nombreuses options non médicamenteuses sont disponibles. Les phytoestrogènes n’ont pas d’activité démontrée sur les bouffées de chaleur importantes. Des options pharmacologiques hors AMM bien évaluées peuvent être proposées : inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, analogues GABAergiques et clonidine.
Les pistes d’avenir incluent différents modulateurs du réseau de neurones hypothalamiques KNDy exprimant kisspeptine (Kiss1), neurokinine B (NKB) et dynorphine.

Voyage et femme enceinte
La grossesse nécessite conseils et mesures préventives lors d’un voyage, et des précautions spécifiques lorsque ce dernier a lieu en zone à risque. Deux visites obstétricales sont alors conseillées, une en amont et la seconde en aval.
Certaines destinations relèvent de connaissances en médecine du voyage. Dans ce cas, une consultation dans un centre spécialisé de médecine du voyage est indiquée.
Enfin, les professionnels de santé suivant les grossesses doivent être sensibilisés aux risques liés au voyage et doivent actualiser leurs connaissances dans ce domaine. Par ailleurs, des recommandations pour les voyageurs sont consultables sur le site de l’InVS.