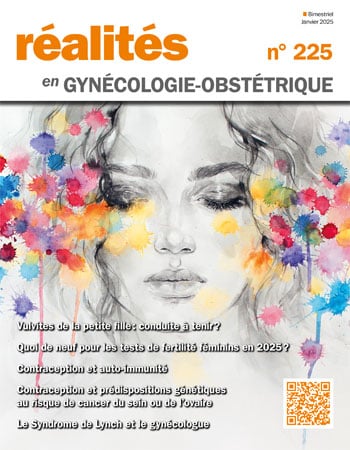Traitement hormonal de l’endométriose douloureuse
L’endométriose est une pathologie très fréquente chez les femmes en âge de procréer.
Outre la question de la fertilité, c’est la prise en charge des symptômes douloureux qui devra guider les propositions de soins, axées autour des thérapeutiques antalgiques médicamenteuses ou non médicamenteuses, des traitements hormonaux et de la prise en charge chirurgicale.
Le choix du traitement hormonal sera fonction des antécédents personnels et familiaux de la patiente ainsi que de son souhait. En première intention, une contraception œstroprogestative (pilule, anneau ou patch) ou un traitement progestatif (contraception orale par désogestrel, implant à l’étonogestrel, dispositif intra utérin au lévonorgestrel ou diénogest) pourront être proposés.
En seconde intention, en cas d’échec des traitements de première ligne, pourra être discutée l’utilisation d’analogues de la GnRH (associés à une add-back therapy combinée si utilisation prolongée) ou de macroprogestatifs (après informations orale et écrite de la patiente et surveillance par imagerie cérébrale si utilisation prolongée).
Les antagonistes de la GnRH seront probablement disponibles prochainement sur le marché français et permettront ainsi d’élargir l’arsenal thérapeutique de cette pathologie gynécologique.

Vaccination dirigée contre les HPV : mise au point
Les papillomavirus humains du genre alpha (α-HPV) oncogènes sont impliqués dans les cancers anogénitaux et ORL avec une fréquence variable selon les sites anatomiques : 99,9 % des cancers du col de l’utérus, 90 % des cancers de l’anus, 50 % des cancers du pénis, 30 % des cancers de l’oropharynx et 40 % des cancers de la vulve.
En France, deux vaccins sont disponibles : une vaccin nonavalent (Gardasil 9) et un bivalent (Cervarix), avec une recommandation claire pour l’utilisation du vaccin nonavalent en raison de sa couverture plus large. L’âge idéal pour vacciner se situe entre 11 et 14 ans, pour les filles comme pour les garçons, mais en l’absence de vaccination, l’adolescent peut tout de même bénéficier de ce vaccin jusqu’à l’âge de 19 ans. Un rattrapage vaccinal est aussi prévu pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes jusqu’à 26 ans, bien que la communauté médicale plaide pour une généralisation de cette extension d’âge à toute la population sans distinction de sexe ni d’orientation sexuelle.

Insuffisance ovarienne prématurée : de nouvelles prises en charge
: L’insuffisance ovarienne prématurée (IOP) est une condition rare caractérisée par une réduction accélérée du nombre de follicules avant l’âge de 40 ans, entraînant des troubles menstruels et des déséquilibres hormonaux. Elle doit être distinguée du syndrome de diminution de la réserve ovarienne (DRO), qui concerne des femmes ayant des cycles réguliers mais une fertilité diminuée. Les causes de l’IOP peuvent être génétiques ou auto-immunes.
Les patientes atteintes d’IOP doivent recevoir un traitement hormonal substitutif (THS) pour gérer les symptômes et les risques associés. Des approches expérimentales pour rajeunir l’ovaire, telles que l’injection de PRP, la technique OFFA ou celle d’ASCOT, sont en cours d’évaluation, mais leur efficacité reste à confirmer.
En France, des plateformes nationales réalisent des analyses génomiques pour identifier les causes de l’IOP et les options de traitement les plus adaptées. Ces efforts sont soutenus par le Plan France Médecine Génomique 2025, qui vise à intégrer la médecine génomique dans le parcours de soins et à favoriser la recherche et l’innovation dans ce domaine.

Anatomie morale de la grossophobie
La forte progression de l’obésité dans les pays occidentaux s’accompagne d’une grossophobie décomplexée qui fait rage sur les réseaux sociaux. Pourquoi un tel acharnement à l’égard de personnes qui sont les premières à souffrir dans leur chair de cette condition peu enviable ? De quoi la grossophobie est-elle le nom ? Que recouvre-t-elle exactement ?
Les témoignages, de plus en plus nombreux, de femmes victimes de cette discrimination ordinaire liée au poids révèlent une très vive douleur, une blessure narcissique béante. La stigmatisation sociale est, dans ce cas, intériorisée et peut se transformer en haine de soi. Les représentations jouent en effet un rôle capital. Le courant récent de body positivity a bien tenté de les modifier, mais, en clamant haut et fort la fierté d’être gros, il nourrit la grossophobie qu’il entend combattre.

Nausées et vomissements gravidiques en 2024. Enquête miroir auprès des patientes et des professionnels de santé
Les nausées et vomissements gravidiques sévères constituent la première cause d’hospitalisation au premier trimestre de la grossesse. Toutefois, ils ne sont pas systématiquement pris en charge. L’étude NAVIGA vise à évaluer par deux questionnaires distincts les pratiques de prise en soins des NVG par les professionnels de santé d’une part et le vécu par les patientes d’autre part. Les résultats montrent que 69 % des patientes souffrent de NVG, affectant leur qualité de vie (fatigue, inconfort vis-à-vis des odeurs, difficultés d’alimentation). Ces différents aspects de la qualité de vie sont considérés à leur juste valeur par les professionnels de santé, qui proposent une prise en soins quasi systématiquement à leurs patientes. Toutefois, celle-ci peut être optimisée et effectuée de manière plus précoce : seulement 20 % des répondants prennent en charge les NVG dès les signes avant-coureurs quand 65 % attendent l’apparition des premiers symptômes. L’étude NAVIGA souligne également la nécessité d’améliorer la prise en soins des NVG notamment en termes d’évaluation de la sévérité, mais aussi de connaissance des méthodes médicamenteuses et non médicamenteuses, d’information aux patientes et de comportement en consultation.

Lichen scléreux génital chez la femme : mise au point
Le lichen scléreux vulvaire (LSV) est une dermatose inflammatoire chronique fréquente, touchant principalement la femme après la ménopause et la petite fille prépubère. Si elle est classiquement prurigineuse, il ne faut pas méconnaître les formes asymptomatiques.
Les aspects cliniques varient, mais on doit retenir l’aspect blanc nacré brillant caractéristique, auquel s’ajoutent – plus ou moins – fissures, hémorragies sous-épithéliales, pigmentation postinflammatoire, modifications architecturales. Le traitement repose essentiellement sur les dermocorticoïdes très forts, avec un traitement d’attaque quotidien, puis un traitement d’entretien de plusieurs mois au moins, souvent pendant des années. Le risque de carcinome épidermoïde est faible chez les patientes traitées et bien suivies.

Contraception de l’adolescente
L’information concernant les modalités d’utilisation et l’efficacité des contraceptifs reste insuffisante chez les adolescentes à ce jour. L’information et la déconstruction des croyances sont indispensables afin, notamment, d’améliorer l’observance de ces jeunes filles. En pratique, tous les contraceptifs sont possibles selon les mêmes contre-indications que chez l’adulte. La consultation pour contraception chez l’adolescente est un moment clé pour aborder les questions de sexualité, de prévention des IST, s’assurer de la vaccination HPV et dépister les situations de violence.

La loi de bioéthique, deux ans plus tard
Cette loi, votée en septembre 2021, apporte des changements notables dans le domaine de la gynécologie-obstétrique, en particulier dans celui des PMA. Même si l’accès aux origines est maintenu, l’expérience montre que c’est moins l’identité du donneur de gamètes qui est recherchée par les demandeurs que celle des “halfies”, les enfants conçus grâce à ce même donneur. L’autoconservation des ovocytes est autorisée, mais rencontre des difficultés d’application. L’interdiction de la GPA est maintenue, de même que la Ropa et que le transfert d’un embryon post mortem.
Un bilan de l’efficacité française en matière de reproduction est esquissé.

La grossesse chez les femmes souffrant d’hypertension pulmonaire : de la conception à l’accouchement
La grossesse chez les femmes souffrant d’hypertension pulmonaire (HTP) est associée à des taux de morbi-mortalité fœto-maternelle significativement élevés, avec une mortalité estimée entre 30 % et 56 %. Ceci est dû aux changements physiologiques qui surviennent pendant la grossesse et la période du péri-partum, qui sont mal tolérés. Nous rapportons trois cas de grossesse chez des patientes atteintes d’hypertension pulmonaire, traitée par bosentan et sildénafil. La césarienne sous anesthésie péridurale a été réalisée chez deux patientes qui ont poursuivi leur grossesse jusqu’à 34 semaines d’aménorrhée, en collaboration avec les obstétriciens et les anesthésistes. Les complications étaient marquées par la survenance d’une mort in utero, prématurité fœtale et décompensation cardiaque droite. Les patientes atteintes d’HTAP désirant poursuivre une grossesse doivent être prises en charge dans un centre hospitalier adapté impliquant une approche pluridisciplinaire, avec des experts de l’hypertension pulmonaire, des obstétriciens et des anesthésistes.

La photobiomodulation : intérêt dans la sécheresse vaginale, les dyspareunies et les douleurs pelviennes
La photobiomodulation (PBM) est une technique de soins qui s’est beaucoup développée depuis quelques dizaines d’années, particulièrement en dermatologie et en ORL. Ses effets sont connus depuis très longtemps et plusieurs milliers de publications scientifiques les ont prouvés et partiellement expliqués. On peut dire que la PBM est, pour la cellule animale, ce qu’est la photosynthèse aux cellules végétales.
Le transfert d’énergie lumineuse en énergie biologique induit des effets cliniques prouvés sur la cicatrisation, la douleur et l’inflammation. Le transfert des connaissances obtenues en dermatologie et en ORL a permis, grâce aux similitudes histologiques, de mettre en place des protocoles de soins très souvent efficaces et toujours sans danger. Il est certain que nous manquons de protocoles précis et d’études rationnelles. Il est certain aussi que si l’aspect empirique déroute notre esprit scientifique, l’expérience quotidienne nous réconforte. L’absence de caractère dommageable ou préjudiciable, le caractère strictement indolore des procédures, la simplicité de leur mise en œuvre incitent à une utilisation quotidienne en tant qu’adjuvant à nos thérapeutiques habituelles. C’est ainsi que la PBM est un procédé qui trouve sa place à la frontière de nos échecs.
En effet, la PBM permet de prendre en charge et d’aider de nombreuses patientes pour lesquelles l’allopathie traditionnelle a montré ses limites en particulier en cas de sécheresse vaginale, de dyspareunie et de douleurs pelviennes.