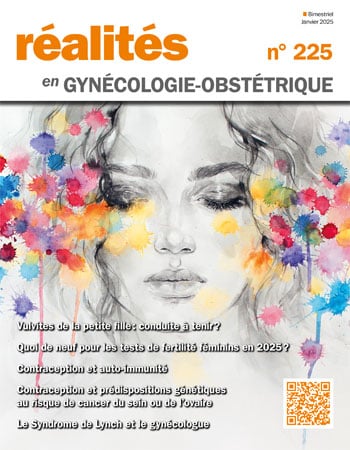Infertilité et alimentation
De nombreux facteurs liés au mode de vie des couples ont été identifiés comme facteurs de risque d’infertilité chez les hommes et les femmes. Le surpoids, l’obésité, les désordres métaboliques sont décrits depuis longtemps comme délétères pour les fonctions de reproduction. Une perte de poids peut d’ailleurs, dans certains cas, inverser les effets.
De plus en plus d’études mettent en avant l’importance d’une alimentation équilibrée et de l’activité physique pour améliorer la fertilité des couples. Dans certaines situations de carence, une supplémentation en micronutriments (antioxydants) peut également être bénéfique. En effet, le stress oxydant semble lui aussi au cœur des mécanismes liant l’alimentation et la fertilité des hommes et des femmes, et c’est un paramètre qui peut être modifié avec l’amélioration du mode de vie.

Les différents aspects cliniques des vulvites candidosiques
Les candidoses représentent la deuxième infection vaginale la plus fréquente. Ainsi, 75 % des femmes auront l’expérience d’au moins un épisode de candidose vulvo-vaginale aigu (CVV) au cours de leur vie. C’est la première cause de prurit vulvaire, d’œdème vulvaire et de leucorrhées blanches.
40 à 50 % de ces femmes connaîtront un deuxième épisode et 6 à 9 % souffriront d’épisodes
récurrents de CVV.

Intérêt de la chirurgie ambulatoire en gynécologie et pour la chirurgie du sein
Le principal intérêt de la chirurgie ambulatoire (CA) gynécologique et du sein est l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patientes : pour “réussir” en CA, toute la prise en charge périopératoire des patientes doit être optimisée (gestion des douleurs postopératoires, nausées, vomissements, réhabilitation, gestion des risques, information et éducation des patientes).
De nombreuses publications ont confirmé que la CA gynécologique et du sein garantissait une qualité des soins et une sécurité des patientes identiques voire meilleures que celles en hospitalisation complète, et que la satisfaction des patientes était très importante.

Traitement par acide hyaluronique de la sécheresse vaginale et des troubles sexuels
La déprivation œstrogénique impacte la vie sexuelle : sécheresse vaginale, dyspareunies et troubles de la libido. Ce phénomène survient chez les femmes après la ménopause et également chez celles traitées pour un cancer du sein par hormonothérapie adjuvante. Le traitement par acide hyaluronique sur la sphère génitale apporte une solution efficace grâce à la réhydratation vaginale.

Contraception hormonale et cancer du sein
Les études publiées à ce jour mettent en évidence un petit surrisque de développer un cancer du sein chez les femmes préménopausées qui prennent la pilule. Ce léger surrisque disparaît à l’arrêt de la contraception orale. Il s’agit probablement d’un effet de promotion sur des cellules cancéreuses préexistantes ou d’un biais de dépistage et d’avance au diagnostic. Il n’a pas été mis en évidence d’excès de mortalité par cancer du sein associé à la pilule.

Que faire devant un polype de l’endomètre ?
Les polypes sont une pathologie intra-utérine fréquente en période d’activité génitale et en postménopause. Ils sont diagnostiqués par échographie, hystérosonographie ou hystéroscopie. Le signe clinique le plus fréquent est la métrorragie. Plus de 85 % des polypes sont bénins. On conseillera
leur ablation (par hystéroscopie opératoire) chaque fois qu’ils sont symptomatiques (métrorragie) et lorsqu’ils sont (uniques ou multiples) :
– > 2 cm en période d’activité génitale ;
– ≥ 5 mm en cas d’infertilité ou d’échecs de prise en charge en assistance médicale à la procréation ;
– ≥ 1 cm en postménopause.

Mutations BRCA1/BRCA2et ménopause
Les femmes prédisposées héréditairement aux cancers du sein et/ou de l’ovaire doivent bénéficier d’un dépistage spécifique mammaire et/ou ovarien. Une annexectomie prophylactique est recommandée en cas de mutation BRCA1/2 à partir de l’âge de 40 ans, pouvant être différée à l’âge de 45 ans en cas de mutation BRCA2.
Un traitement hormonal de substitution (THM) peut être proposé chez les femmes symptomatiques porteuses d’une mutation de BRCA1/2 et indemnes de cancer du sein, après annexectomie bilatérale, y compris chez les femmes n’ayant pas réalisé de mastectomie. Chez les femmes sans symptômes climatériques mais ayant eu une annexectomie avant l’âge de 45 ans, le THM peut se discuter.
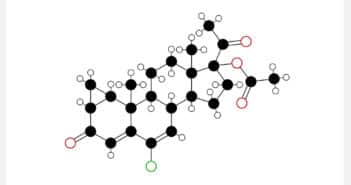
Androcur : quels risques ?
L’acétate de cyprotérone (Androcur) est un progestatif à forte activité antiandrogène. Ses indications AMM sont les hirsutismes féminins majeurs d’origine non tumorale (idiopathique, syndrome des ovaires polykystiques) lorsqu’ils retentissent gravement sur la vie psycho-affective et sociale.
Chez l’homme, c’est un traitement palliatif antiandrogénique du cancer de la prostate. Il est également indiqué pour réduire les pulsions sexuelles dans les paraphilies en association à une prise en charge psychothérapeutique.
Ses effets secondaires classiques sont bien connus, notamment le risque thromboembolique. Récemment, l’attention a été attirée sur le risque de méningiome sous cette molécule. Des recommandations ont été adressées aux prescripteurs par l’ANSM pour limiter les risques dans les indications de l’AMM. La prescription hors AMM est par contre à proscrire.

Clampage retardé du cordon
Le clampage retardé du cordon ombilical est une des méthodes permettant le passage du sang résiduel placentaire au nouveau-né. Outre ses bénéfices hématologiques, certains à court et moyen terme, cette transfusion de sang oxygéné améliore la stabilité hémodynamique du nouveau-né lors de cette période d’adaptation à la vie extra-utérine.
Il semble indispensable d’attendre l’instauration des premiers cycles respiratoires pour couper le cordon afin de respecter la physiologie du nouveau-né. Des méthodes alternatives comme la traite du cordon en cas d’urgence obstétricale ou de besoin de réanimation néonatale immédiate ont montré des effets bénéfiques similaires au clampage retardé.

Les maux de la femme allaitante
La prise en charge des inflammations du sein doit être précoce. Le drainage du sein est primordial, associé à un antidouleur, et la guérison doit être rapide. Si ce n’est pas le cas, la réactivité est essentielle pour passer à l’étape suivante et éviter des complications qui mettraient en péril l’allaitement.
Pour les douleurs du sein ou plus spécifiquement du mamelon, l’examen clinique est essentiel ainsi que la surveillance rapprochée.
La plupart des médicaments peuvent être prescrits durant l’allaitement. Le CRAT (Centre de référence sur les agents tératogènes) est une référence de choix en cas de doute.
Enfin, l’inhibition de la lactation par traitement médicamenteux doit se faire au cas par cas et la cabergoline est à privilégier.