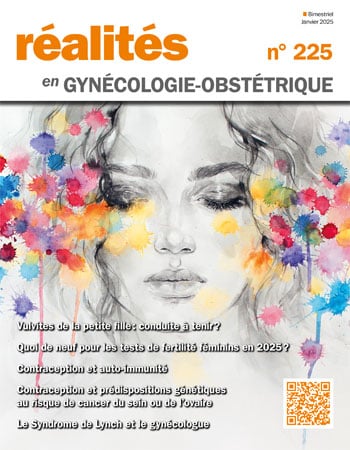Quelles actualités sur l’usage de cannabis en cours de grossesse ?
La prévalence de l’usage du cannabis en cours de grossesse a significativement augmenté depuis les années 2000. L’extension de sa légalisation et de son usage thérapeutique peuvent laisser penser à une innocuité du produit. Les études récentes, bien que contradictoires, montrent quant à elles un risque accru de prématurité, de plus petit poids de naissance et davantage d’hospitalisations en néonatalogie.
Les travaux concordent sur les conséquences chez les nouveau-nés : augmentation de la fréquence des trémulations et des troubles du sommeil. Conseiller l’allaitement maternel n’obtient pas le consensus. Les troubles neuro-développementaux, des fonctions exécutives, du comportement et de la gestion des émotions sont majorés pendant l’enfance et l’adolescence. Les initiations de consommation sont plus précoces et plus souvent maintenues. À long terme, l’exposition in utero accroîtrait le risque de troubles psychotiques et dépressifs. La prise en charge des femmes enceintes doit être empathique, pluridisciplinaire et en réseau.

La photobiomodulation en gynécologie
Dans l’arsenal des thérapies traitant l’inflammation et la cicatrisation, il existe beaucoup de traitements. La lumière est une nouvelle aide au service du gynécologue. Cette énergie lumineuse aide à restaurer l’homéostasie des tissus via les mécanismes de réparation de l’organisme, lequel dispose ainsi de l’énergie nécessaire pour agir ensuite de manière autonome sur la régulation des processus de l’inflammation, de la cicatrisation, de l’infection et de la douleur. Ce traitement athermique et sans danger, basé sur l’interaction énergie-matière vivante, disposant de plus de 6 000 publications internationales, porte le nom (adopté par tous les pays) de photobiomodulation, ou PBM.
L’intérêt le plus évident de la PBM résulte dans son mode d’action : elle est efficace uniquement sur un tissu perturbé, n’ayant aucune action sur un tissu normal. Le retour de la microcirculation à son état normal conduit à la régulation à long terme des échanges biochimiques perturbés. “Primum non nocere” est donc l’adage qui convient le mieux à la PBM.

Dysthyroïdies et grossesse
La grossesse est marquée par des modifications physiologiques du fonctionnement thyroïdien qu’il convient de prendre en compte lors de l’interprétation des bilans chez les femmes enceintes. Les dysthyroïdies non équilibrées chez la mère au cours de la grossesse sont associées à une augmentation du risque obstétrical et peuvent parfois avoir un retentissement sévère sur le fœtus et l’enfant à naître sur le plus long terme.
Parmi les dysthyroïdies, la maladie de Basedow correspond à une situation complexe dont la prise en charge est spécifique pendant la grossesse du fait d’un risque fœtal et néonatal accru. Dans ces situations, une prise en charge multidisciplinaire spécialisée est requise.

Chirurgie bariatrique et tissu osseux
En dépit des bénéfices bien connus sur les comorbidités liées à l’obésité, de plus en plus de données impliquent la chirurgie bariatrique dans l’apparition d’effets néfastes sur la santé du squelette. La sleeve gastrectomie (SG), devenue la chirurgie bariatrique la plus couramment pratiquée, est accompagnée d’une perte osseuse d’environ 3 à 7 % au niveau du squelette axial dans les 6 à 24 mois suivant l’opération. Cette baisse de la densité minérale osseuse (DMO), bien qu’elle soit importante, l’est moins que celle qui a été décrite après la dérivation gastrique de Roux-en-Y par laparoscopie (RYGB). Les données d’observation indiquent de façon constante une augmentation de 1,3 à 2,3 fois du risque de fracture suite à la chirurgie bariatrique. Cependant, le risque semble varier selon le type de chirurgie et est plus élevé après RYGB. De plus amples informations concernant le risque de fracture associé au SG sont nécessaires.
Une approche clinique holistique et multifactorielle est actuellement recommandée pour prévenir la perte osseuse secondaire à la chirurgie bariatrique. Des essais conçus pour optimiser l’adhésion aux stratégies d’intervention basées sur des changements de mode de vie et les effets du traitement sont nécessaires pour guider les praticiens sur la meilleure façon de gérer les conséquences squelettiques potentiellement coûteuses de la chirurgie bariatrique.

Conséquences de l’hormonothérapie adjuvante des cancers du sein sur les suites opératoires après reconstruction mammaire
L’hormonothérapie tient une place importante dans le traitement adjuvant des cancers du sein hormonosensibles. Plusieurs études se sont intéressées au lien entre hormonothérapie et complications thromboemboliques veineuses ou thromboses microvasculaires après reconstruction mammaire, avec des résultats contradictoires. Cependant, alors que les estrogènes jouent également un rôle crucial dans la cicatrisation cutanée, aucune étude n’a évalué l’impact du tamoxifène ou des inhibiteurs de l’aromatase sur les autres complications chirurgicales, notamment cicatricielles. Nous avons réalisé une étude rétrospective comparant les complications des reconstructions mammaires autologues et prothétiques chez les patientes recevant une hormonothérapie au moment de l’intervention et chez celles n’en recevant pas. L’hormonothérapie semble associée à un risque augmenté de complications cicatricielles et de coques périprothétiques. Des recommandations sur la gestion périopératoire de ces traitements sont nécessaires.

Risque des molécules antipsoriasiques chez la femme en âge de procréer : avons-nous toutes les assurances ?
Un désir de grossesse, rarement verbalisé lors des premières consultations, peut rapidement être le sujet de préoccupation d’une patiente atteinte de psoriasis cutané, une fois les plaques prises en charge et la qualité de vie améliorée en conséquence. La révolution thérapeutique des dernières années a permis de proposer des prises en charge plus personnalisées et nécessite plus de pédagogie auprès de nos patientes pour adapter les traitements de la phase préconceptionnelle, du 1er ou du 3e trimestre et, bien sûr, de l’allaitement. Cela ne sera réalisable qu’en connaissant parfaitement les limites de chaque molécule utilisée.

Cancer de l’endomètre et fertilité
Le cancer de l’endomètre est le cancer gynécologique pelvien le plus fréquent en France avec plus de 8 000 nouveaux cas par an. Ses facteurs de risque sont bien identifiés et essentiellement en rapport avec une hyperestrogénie “constitutionnelle” (nulliparité, obésité). Mais l’hyperestrogénie peut également être induite par les traitements hormonaux de l’infertilité qui constitue en soi un facteur de risque de cancer de l’endomètre. Il n’est pas exceptionnel que le cancer de l’endomètre soit diagnostiqué chez des femmes jeunes, en âge de procréer. Dans ce cas, son diagnostic est régulièrement posé lors de l’exploration d’une infertilité. Il est possible chez ces patientes et sous certaines conditions de préserver leur fonction gonadique, voire leur fertilité.

Que faire des polypes intra-utérins ?
Un polype endométrial doit être recherché chez des patientes symptomatiques, infertiles et/ou dans des situations spécifiques comme la prise de tamoxifène. En cas de découverte fortuite chez une patiente de moins de 35 ans, asymptomatique et fertile, l’indication d’une polypectomie est discutable. Dans tous les autres cas, et selon les facteurs de risque (ménopause, âge supérieur à 60 ans, obésité, HTA, tamoxifène et/ou métrorragies), un polype doit être réséqué. Chez les patientes hypofertiles, la polypectomie améliore la fertilité (spontanée et par AMP) et diminue le taux de fausse couche précoce.

Comment gérer la prise de poids à la ménopause ?
La prise de poids à la ménopause n’est pas une fatalité. Elle s’associe à une diminution de la masse maigre liée à l’âge et à une répartition abdomino-viscérale du tissu adipeux liée à la carence hormonale. Elle s’accompagne d’une augmentation du risque cardiovasculaire. Elle débute avant la ménopause et est liée à une réduction des dépenses énergétiques en raison de la baisse de la masse maigre et de l’activité physique. Sa prise en charge doit comporter des conseils alimentaires et une incitation à accroître l’activité physique. Les régimes alimentaires restrictifs altèrent le comportement alimentaire et réduisent la masse musculaire et osseuse.

Nouvelle stratification du risque cardiovasculaire de la femme française : le consensus “Cœur, artères et femmes” de la SFHTA, filiale de la SFC
Les maladies cardiovasculaires sont devenues en 30 ans la première cause de morbi-mortalité
chez les femmes en France. Cette urgence épidémiologique s’explique par le mode de vie délétère des femmes et par des prises en charge insuffisantes. Plus de 80 % des femmes ont au moins deux facteurs de risque cardiovasculaire (FRCV) après 45 ans, facteurs de risque qui sont aussi moins bien contrôlés chez elles. Les femmes sont également exposées à des facteurs de risque hormonaux ou à des situations émergentes à risque.
Les scores de risque classiques ne tiennent pas compte de ces spécificités féminines. Seule la stratification américaine du RCV permet une prise en charge plus ciblée chez la femme. Tout récemment, à l’initiative de la Société Française d’HTA, un consensus d’experts (“HTA, hormones et femmes”) a proposé une nouvelle stratification du RCV de la femme, prenant en compte les FRCV classiques, les facteurs de risque hormonaux et les situations à risque émergentes. Le consensus a pour vocation de guider la prise en charge des femmes et de discuter avec elles, quand cela est nécessaire, de la balance bénéfice/risque de la contraception et du traitement hormonal de la ménopause.