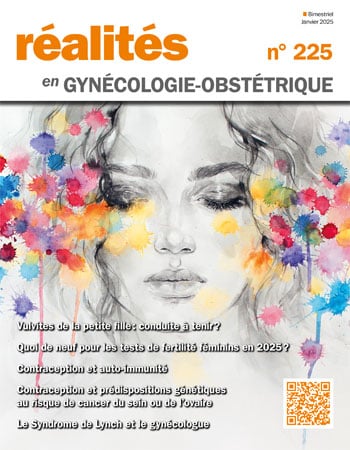Quelle courbe de croissance utiliser ?
Le dépistage des anomalies de croissance n’est pas satisfaisant en France, notamment un taux de dépistage de petit fœtus pour l’âge gestationnel très insuffisant, avec une sensibilité proche de 20 %. De plus, l’apparition récente des courbes prescriptives a amené les sociétés savantes à évaluer ces nouvelles courbes par rapport aux courbes descriptives utilisées actuellement. Il a été ainsi montré que les courbes locales conduiraient à un possible sous-diagnostic des petits périmètres crâniens et donc des microcéphalies ainsi que des PAG/RCIU. Les courbes prescriptives Intergrowth sous-estimeraient les fœtus PAG en surestimant les fœtus GAG. Ainsi, les sociétés savantes françaises recommanderaient dorénavant d’utiliser les courbes de biométrie élémentaire (PC, PA, LF), ainsi que la courbe d’EPF par sexe, de l’OMS, car ce référentiel rapporterait une proportion de fœtus dépistés adéquate à la population française. Enfin, ces mêmes sociétés recommanderaient l’utilisation des courbes néonatales et postnatales de Fenton actualisées.