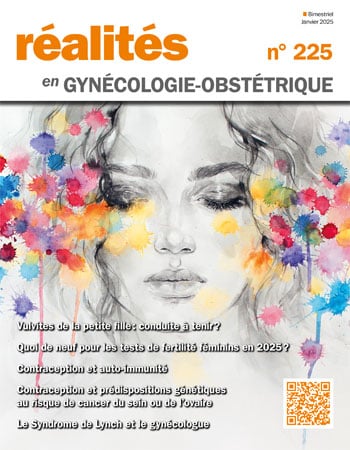Quoi qu’on en dise, le cancer du sein est responsable de plus de 11 000 décès par an en France. Réduire la mortalité liée au cancer du sein reste un objectif fondamental en termes de santé publique.
Le dépistage organisé a permis une amélioration fondamentale du parc des mammographies et une formation des radiologues et des manipulatrices. Pour l’ensemble des femmes concernées âgées de 50 à 74 ans, il permet un égal accès à un dépistage de qualité sans barrières économiques. Il offre une double lecture de qualité réduisant au maximum les risques de faux négatifs.
Le dépistage organisé permet aussi une évaluation des pratiques et une évaluation des cancers diagnostiqués dans son cadre. Le bénéfice en termes de réduction de la mortalité est de l’ordre de 20 à 40 % selon les études prises en compte et selon la population de référence choisie (femmes invitées à participer au dépistage ou femmes y participant réellement).
Les progrès thérapeutiques réalisés depuis les années 1970 réduisent, et c’est tant mieux, l’efficacité du dépistage en augmentant les chances de guérison des patientes, mais ce n’est pas une raison pour abandonner le dépistage. C’est un choix de société, un choix économique, mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, ce serait un grand bond en arrière pour les femmes.