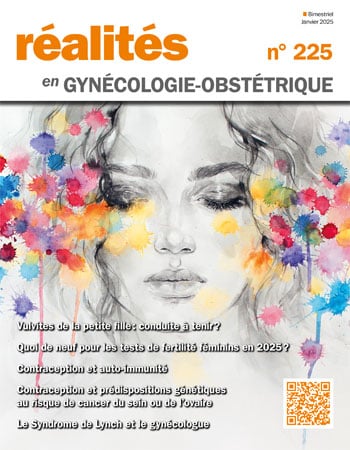Le syndrome des ovaires polykystiques : les critères de Rotterdam en question ?
Les critères de Rotterdam publiés en 2003 sont encore présents dans les diverses publications actuelles sur le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Cependant, de nombreux articles les remettent en question, essayant de retrouver des critères échographiques ou biologiques moins subjectifs ou difficiles à rechercher pour le praticien. Les recommandations récentes de 2018 semblent finalement approuver ces critères, parfois un peu revisités, dans le diagnostic du SOPK, mais à prendre avec prudence, notamment chez les jeunes filles.