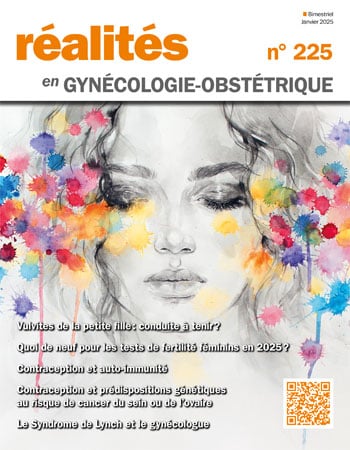Indications actuelles de l’aspirine en cas d’antécédent de prééclampsie
L’aspirine utilisée à faible dose est un antiagrégant plaquettaire recommandé en prévention secondaire de la prééclampsie. Ses modalités de prescription sont maintenant bien définies en France : 100 à 160 mg initiés avant 16 semaines d’aménorrhée (SA ; maximum 20 SA) et poursuivis jusqu’à 36 SA, uniquement chez les femmes ayant un antécédent de pathologie vasculo-placentaire (prééclampsie, retard de croissance in utero d’origine vasculaire, mort fœtale in utero d’origine vasculaire, hématome rétroplacentaire).