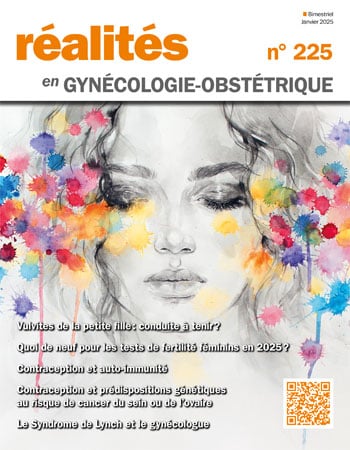Le cancer du sein touche chaque année 58 000 femmes par an en France et 12 000 en décèdent. La mortalité par cancer du sein diminue d’environ 1 % par an mais reste trop élevée [1]. Le but des traitements adjuvants est donc d’augmenter les chances de guérison en réduisant au maximum le risque de survenue de métastases via l’éradication des micrométastases indétectables. Nous proposons en fait des traitements sur un risque statistique de survenue de métastase sans que l’on sache avec certitude si la patiente que l’on a devant nous va en bénéficier ou pas.
Nous savions depuis longtemps qu’il n’existait pas un cancer du sein mais de nombreuses formes et presque autant de cancers du sein que de patientes. Les travaux de Sørlie et Perou [2], par l’étude des gènes tumoraux, ont permis de mieux classifier les tumeurs des patientes et de définir 4 groupes cliniques : les tumeurs luminales A, luminales B, HER2 enrichies et basal-like. Cette classification a pu être reproduite indirectement avec, en immuno-histochimie, la détermination des récepteurs des estrogènes, de la progestérone, de la surexpression de HER2 et du Ki67 (marqueur de prolifération) (fig. 1).
Par définition, les tumeurs luminales A sont des tumeurs RE+, RP+, HER2- et avec un Ki67 inférieur à 15 %. Ce sont des tumeurs hormonosensibles, peu proliférantes et le plus souvent de bas grade. Les tumeurs luminales B sont des tumeurs exprimant généralement moins les récepteurs hormonaux (les récepteurs de la progestérone sont souvent négatifs) et le Ki67 est supérieur à 15 %, HER2 est négatif. Pour les tumeurs surexprimant HER2, il en existe deux variétés certaines avec des récepteurs hormonaux négatifs, d’autres moins nombreuses avec des récepteurs hormonaux positifs. Enfin, il existe des tumeurs dites triple négatives (RE-, RP-, HER2-) qui correspondent à des tumeurs très indifférenciées et généralement très proliférantes (il existe cependant de rares cas de cancers triple négatifs de variétés anatomopathologiques rares et de bon pronostic comme les cancers adénoïdes kystiques).
D’autres paramètres, classiques, vont intervenir dans les choix thérapeutiques : l’âge de la patiente, son état général et ses comorbidités, la taille tumorale, l’envahissement ganglionnaire, le grade, les emboles tumoraux, l’existence de signes inflammatoires, le type anatomopathologique… On va donc prendre en compte à la fois la classification moléculaire et les facteurs pronostiques[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire