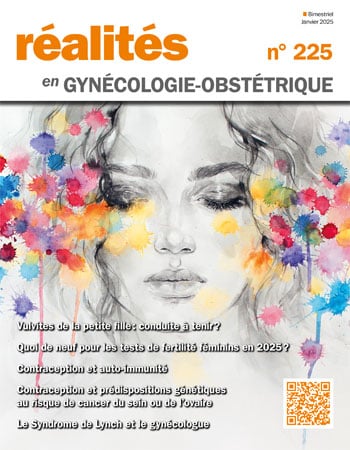La maladie de Willebrand (MW) est due à un défaut génétique de la concentration ou de la fonction du facteur Willebrand (VWF), essentiel à l’hémostase primaire et à la coagulation. Le VWF permet l’adhésion des plaquettes au sous-endothélium vasculaire des vaisseaux lésés, étape essentielle de la coagulation, et transporte le facteur VIII. La maladie est caractérisée par un mode de transmission et une présentation clinique et biologique très hétérogènes. En effet, si les anomalies biologiques isolées sont probablement les anomalies constitutionnelles de l’hémostase les plus fréquentes, les formes symptomatiques de la MW sont rares, touchant sans doute moins de 10 000 patients en France.
La prévalence de la forme sévère (MW de type 3) a été estimée entre 0,5 et 5 par million d’habitants.
Le diagnostic repose sur l’association d’un syndrome hémorragique cutanéomuqueux (personnel) (avec parfois des antécédents familiaux) à des anomalies biologiques. Une classification des différentes formes de la maladie existe pour orienter la prise en charge, elles sont de trois types : le type 1 (le plus fréquent) correspond aux déficits quantitatifs modérés, le type 3 aux déficits quantitatifs sévères, et les types 2 aux déficits qualitatifs, divisés en 4 sous-types (2A, 2B, 2N et 2M). Les types 1, 2A, 2B et 2M sont en très grande majorité de transmission autosomale dominante, tandis que les types 2N et 3 sont de transmission autosomale récessive (tableau I) [1].
Alors que la transmission génétique autosomale prédit que les deux sexes héritent d’allèles VWF mutés dans la même proportion, il y a une plus grande fréquence de formes symptomatiques chez les femmes en raison du défi hémostatique représenté par la menstruation, la grossesse et l’accouchement.
Précautions avant la grossesse
Avant la conception, le risque hémorragique doit être discuté avec les patientes atteintes de MW, et toute grossesse, quel que soit le type de MW, doit faire l’objet d’un suivi multidisciplinaire (obstétricien, hématologiste, anesthésiste et néonatalogiste). En effet, les femmes atteintes de formes sévères de la maladie (essentiellement de type 2 et de type 3, mais également certains types 1 sévères) présentent un risque accru de complications hémorragiques au cours de la grossesse, notamment[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire