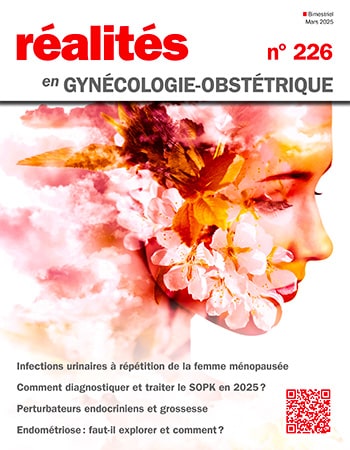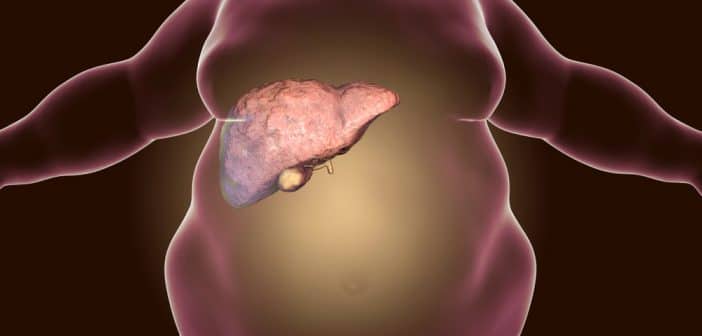La stéatose hépatique aiguë gravidique (SHAG) est une maladie spécifique de la grossesse. Décrite initialement au début du xxe siècle [1], elle survient au 3e trimestre le plus souvent, la majorité des cas survenant entre la 30e et la 38e semaine. Néanmoins, quelques rares cas ont été rapportés avant la 28e semaine. De rares cas de SHAG ont par ailleurs été décrits en post-partum.
Il s’agit d’une pathologie rare dont la fréquence exacte est difficile à évaluer. Selon les séries, l’incidence serait d’un accouchement sur 13 328 aux États-Unis [2], de 1/1 000 au Pays de Galles [3] et, plus récemment, de 1/20 000 au Royaume-Uni [4]. Bien que rare, cette pathologie peut rapidement mettre en jeu le pronostic vital de la mère et de l’enfant.
Son pronostic s’est considérablement amélioré ces dernières années grâce à l’extraction fœtale précoce et à la prise en charge multidisciplinaire de la mère et de l’enfant.
Présentation clinique
La SHAG peut toucher toutes les femmes enceintes, quels que soient l’âge, l’origine géographique ou le caractère primipare ou multipare. À ce jour, il n’a pas été décrit de facteur épidémiologique prédisposant mais il peut exister une récurrence de la SHAG lors d’une grossesse ultérieure.
À un stade précoce, la SHAG se traduit par une symptomatologie peu spécifique (nausées, vomissements dans 75 % des cas et douleurs épigastriques dans 50 % des cas), éventuellement associée à un syndrome toxémique (HTA) dans 50 % des cas. Le syndrome polyuro-polydipsique, considéré comme plus caractéristique, n’est présent que chez 10 % des patientes. En cas d’absence de diagnostic à la phase précoce, la SHAG évolue vers un tableau d’insuffisance hépatocellulaire potentiellement mortel pour la mère et le fœtus, associant encéphalopathie hépatique et troubles de l’hémostase accompagnés d’insuffisance rénale aiguë et d’hypoglycémie [5, 6].
Examens diagnostiques
Une hypertransaminasémie pouvant aller de la limite supérieure de la normale jusqu’à > 500 UI/L est le premier signe évocateur. Une hyperuricémie, une hyperleucocytose, une thrombopénie et une élévation de l’INR sont habituellement rencontrées [6]. Une coagulation intravasculaire[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire