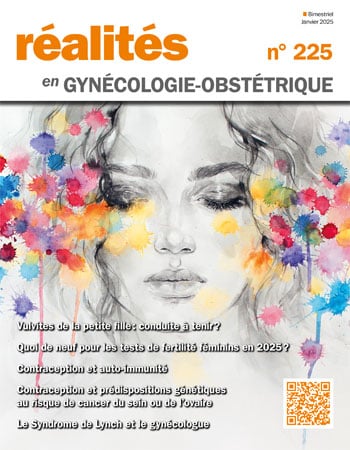Les troubles vasomoteurs incluant bouffées de chaleur et sudations nocturnes affectent 50 à 75 % des patientes pour une durée moyenne de 4 ans et vont persister chez 15 % d’entre elles pendant une vingtaine d’années [1]. Les mécanismes physiopathologiques ne sont pas encore clairement élucidés. Ils incluent la chute des estrogènes et/ou des stéroïdes sexuels et une rupture de l’équilibre hypothalamique de divers neurotransmetteurs tels que la noradrénaline ou la sérotonine [2]. La réduction de l’amplitude de la “zone de neutralité thermique” serait liée à des modifications du tonus alpha-adrénergique central, alors que le rôle de l’élévation des gonadotrophines semble désormais moins vraisemblable [2].
Les anomalies du tonus opioïde sont également suspectées dans la physiopathologie des bouffées de chaleur et sources de développement thérapeutique [3]. Ces anomalies seraient à l’origine du dérèglement du point d’équilibre thermique, avec une très discrète augmentation de la température centrale et du rythme cardiaque durant la bouffée de chaleur et de la vasodilatation [2].
Enfin, ces dysfonctionnements pourraient entraîner la dérégulation de l’activité des neurones KNDy situés à proximité des neurones à GnRH dans l’hypothalamus et impliqués dans la modulation de leur fonctionnement pulsatile par les estrogènes. Ces neurones expriment la kisspeptine (Kiss1), la neurokinine B et la dynorphine, qui régulent la pulsatilité de la GnRH et de la LH [3, 4]. L’expression de la dynorphine est réprimée par les opioïdes (via un récepteur kappa opioïde présent sur les neurones à dynorphine). Chez les femmes ménopausées, l’activité des neurones NKDy est globalement augmentée [3, 4] et contribuerait à l’élévation de la température corporelle [5].
L’évaluation des traitements des bouffées de chaleur [2] est rendue difficile par la compliance à la tenue des carnets de suivi et le biais de mémoire, notamment concernant les bouffées de chaleur nocturnes. Des outils de mesure de la vasodilatation cutanée (capteur de conductance cutanée) ont été développés, initialement contraignants et actuellement miniaturisés et mieux acceptés [6]. Enfin, un effet placebo majeur est observé, atteignant[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire