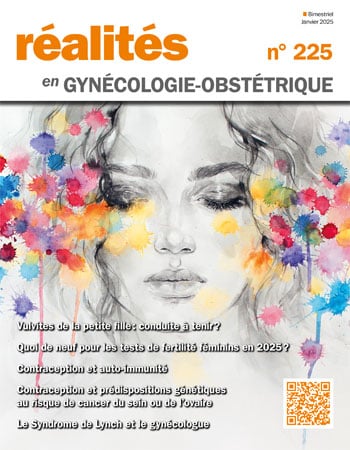L’embolisation des artères utérines a été introduite par Ravina et al. [1] en 1995 afin de réduire les pertes sanguines lors de la myomectomie. Depuis, ce traitement est une alternative aux traitements chirurgicaux des fibromes utérins symptomatiques (métrorragie, dysménorrhée, syndrome de masse). Mais qu’en est-il de son application aux fibromes utérins sous-muqueux de grande taille ? Nous reportons ici le cas d’une patiente ayant bénéficié d’une embolisation des artères utérines dans le cadre d’un fibrome utérin de grande taille symptomatique.
Observation
Une patiente de 39 ans, multipare, sans antécédent personnel ni familial particulier (si ce n’est une mère aux antécédents de fibromes utérins), consulte pour un utérus fibromateux avec un syndrome de compression pelvienne associant une pesanteur pelvienne, une dysurie, ainsi qu’une incontinence urinaire d’effort et des infections urinaires à répétition. Elle ne présente pas de ménométrorragies, mais des cycles réguliers de 28 jours.
La patiente n’a aucun désir de grossesse, mais est formellement opposée à toute chirurgie. Une première IRM pelvienne retrouve un volumineux fibrome interstitiel du fond utérin de 11 x 10 x 11 cm, soit un volume de 633,19 cm³. Un traitement médical est débuté par ulipristal acétate durant 3 mois. À l’issue de celui-ci, l’IRM de réévaluation retrouve une augmentation de la taille du fibrome, mesurant désormais 15 cm de grand axe crânio-caudal, 10 cm d’axe antéropostérieur et 12 cm de largeur, soit un volume de 941,94 cm³. Celui-ci a un aspect encapsulé et fortement vascularisé avec une distribution artérielle normale des artères utérines. La patiente est toujours déterminée à n’avoir aucune chirurgie. Son dossier est alors présenté au radiologue interventionnel pour discuter d’une éventuelle embolisation des artères utérines (fig. 1A).
Les 3 mois suivants, la patiente est mise sous analogue de la GnRH sans effet assez satisfaisant sur la taille du fibrome, avec une dernière IRM visualisant un fibrome de 14 x 11 x 10 cm (805,88 cm³). Par la suite, une embolisation des artères utérines est donc réalisée sous sédation et anesthésie locale. L’occlusion des artères utérines est obtenue grâce à des microsphères de 700 µm (7 ampoules de 2 mL) par abord transfémoral droit. L’analgésie postopératoire est contrôlée par PCA de morphine, son EVA (échelle visuelle analogique) en salle de réveil se chiffre à 3/10. Les suites précoces sont simples et la patiente[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire