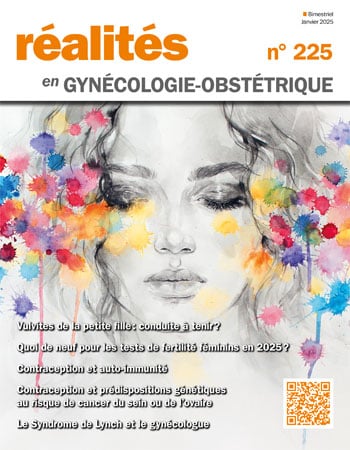Les malformations utérines
1. Généralités
La prévalence des malformations congénitales utérines est proche de 5,5 % dans la population générale mais est difficile à estimer et probablement sous-diagnostiquée. Elle s’élève à 8 % chez les femmes infertiles et 13 % en cas de fausses couches à répétition [1].
Les malformations du tractus génital sont liées à des anomalies du développement des canaux de Müller. Leur importance est très variable en fonction du stade embryologique de l’anomalie, pouvant aller d’une simple cloison vaginale à l’absence totale d’axe utéro-vaginal. De ce fait, l’âge et les circonstances de découverte d’une malformation utérine sont très variables et dépendent de la présence ou non d’un utérus fonctionnel et de la perméabilité des voies génitales [2].
Le diagnostic peut être établi de façon directe en associant l’examen clinique, l’hystéroscopie voire la cœlioscopie. Ces examens invasifs tendent à être remplacés par l’imagerie, en utilisant par exemple, pour certaines anomalies intracavitaires, une reconstruction tridimensionnelle de l’utérus en échographie, que l’on complète par une hystérosonographie [3]. L’IRM, moyen d’imagerie plus coûteux et plus difficile d’accès, permet aussi de diagnostiquer et de distinguer les différents types de malformations.
Concernant la découverte de ces anomalies en cours de grossesse, l’échographie de datation est un moment particulièrement important pour le dépistage des anomalies de la cavité utérine, permettant ainsi une prise en charge précoce.
Les anomalies utérines dans leur globalité induisent différentes complications obstétricales. La prévalence de la prématurité (< 37 semaines d’aménorrhée[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire