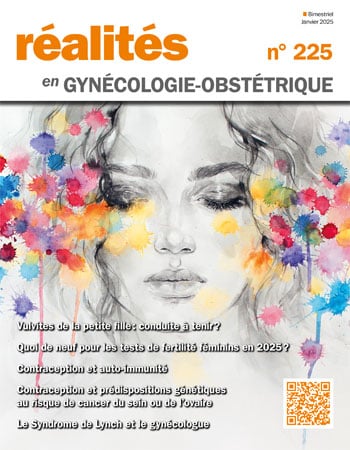Les grossesses môlaires représentent en Europe occidentale 1 grossesse sur 1 000. Les facteurs de risque reconnus sont peu nombreux et seuls l’âge maternel, avec des incidences augmentées aux deux extrêmes de la vie reproductive, et l’antécédent de grossesse môlaire font consensus.
L’Organisation mondiale de la Santé a proposé une classification histologique qui ne rend pas complètement compte de toutes les entités cliniques, en particulier tumorales. Elle différencie deux types de grossesse môlaire.
- Les grossesses môlaires partielles (fig. 1)
Elles sont plus fréquentes que les formes complètes. Elles résultent d’une anomalie conceptionnelle, responsable d’une triploïdie androgénétique. Ce caractère triploïde ne peut pas être affirmé par un examen histologique standard. La présentation clinique habituelle est celle d’une fausse couche, avec un aspect échographique variable. Il existe des éléments embryonnaires possiblement visibles, en échographie comme en histologie. Le trophoblaste peut avoir un aspect trop volumineux et vacuolaire, mais la performance de l’échographie dans le diagnostic des môles partielles n’est que de 30 % dans la majorité des séries. Le taux d’hCG (gonadotrophine chorionique humaine)n’est augmenté que dans 10 % des cas.
- Les grossesses môlaires complètes
Elles sont habituellement diploïdes génétiquement, par diandrie (la totalité du matériel génétique nucléaire est d’origine paternelle). La présentation clinique classique est celle d’une masse trophoblastique vésiculaire volumineuse. Il n’y a pas d’éléments embryonnaires visibles, ni en échographie ni en histologie. La performance diagnostique de l’échographie est bonne autour de 90 %. Le taux d’hCG n’est supérieur à 100 000 UI/L que dans 46 % des cas (fig. 1). Le tableau “historique” associant prééclampsie, hyperthyroïdie, vomissements incoercibles ou détresse respiratoire est devenu exceptionnel. Les signes les plus fréquents sont actuellement de simples métrorragies du 1er trimestre associées à un utérus trop volumineux pour le terme.
Traitement et surveillance
En cas de suspicion diagnostique (fig. 2), le traitement de 1re intention est l’aspiration curetage sous contrôle échographique. Dans notre expérience, le geste est habituellement simple, et les formes hémorragiques le sont surtout pour les cas au-delà de 16 semaines d’aménorrhée. La préparation du col par du misoprostol est possible dans notre centre, afin de faciliter[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire